
L’automatisation va créer des emplois
Cela fait trois ans que ce chiffre ne nous quitte plus : 47%, ou comment d’ici à 2034, presque la moitié des emplois seraient automatisés. Depuis la parution de cette étude anglaise, une véritable panique robotique c’est emparée de nos timelines.
C’est ainsi qu’à l’heure des fake news de Facebook et des guérisseurs-magnétiseurs de l’innovation sur Linkedin, il semblerait que nous ne puissions plus échapper à un futur sans travail.
Chez Enigma, nous ne partageons pas ce point de vue. Pour nous, l’automatisation actuelle s’inscrit plutôt dans une continuité historique. Nous pensons donc que les intelligences artificielles et la robotique vont en fait permettre de créer de nouveaux emplois.
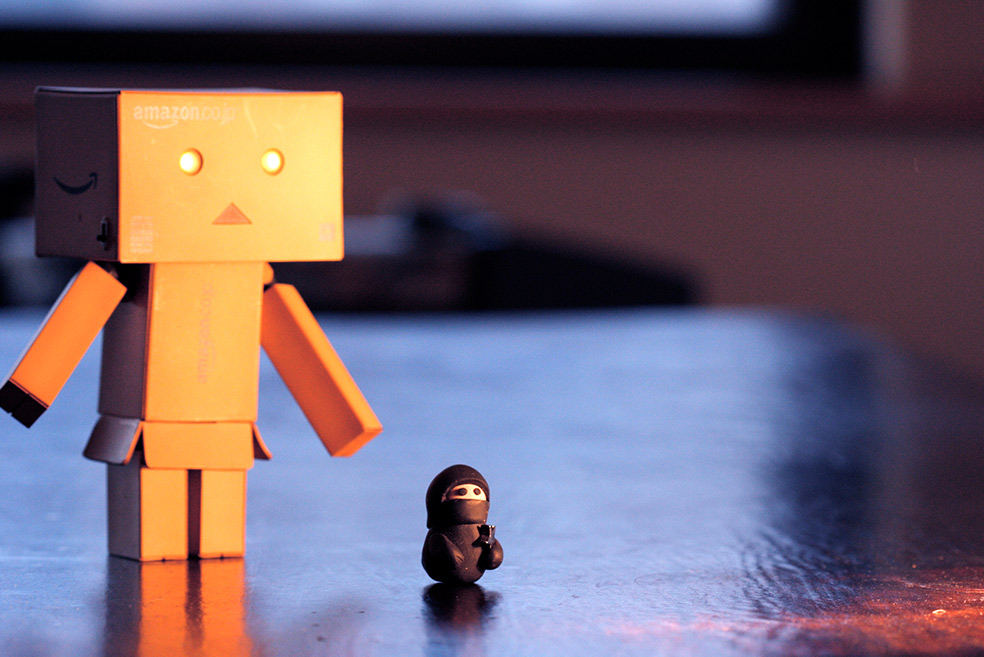
Alors 47%, vraiment ?
Cette fameuse étude et ce 47% d’automation potentielle a été remis en question plusieurs fois et notamment par l’OCDE, qui dans l’ensemble, constate qu’en moyenne pour les 21 pays de l’OCDE, seulement 9% des emplois sont automatisables.
Alors pourquoi un tel écart, une telle hystérie médiatique? C’est assez simple, la fameuse étude anglaise fait l’erreur grossière de considérer les emplois d’un point de vue de métiers et non de tâches. Perdant ainsi de vue qu’au sein d’un même métier nous avons des tâches très hétérogènes. Mais ça fait peur. Et les émotions, comme les tweets de Donald Trump, c’est très vendeur.
Et l’humanité ? De plus en plus productive grâce aux machines ?
Avec la complexité des environnements économiques, la volatilité des marchés, les bureaucraties et un management souvent dépassé, la perte de sens au travail, avec une épidémie mondiale de burnout, des systèmes IT archaïques, des conflits et fossés générationnels… le monde du travail est aujourd’hui en panne. Et malgré nos innovations technologiques, l’humanité est de moins en moins productive. Et tout le monde le ressent bien! Il est alors facile d’imaginer que des machines pourraient nous remplacer.
Toutefois, si les robots et les intelligences artificielles étaient véritablement en train de prendre nos emplois, la productivité des travailleurs qui ont encore des emplois – la quantité totale de travail divisée par le nombre total de personnes employées – devrait augmenter rapidement. Mais ce n’est pas le cas. Cette productivité est globalement en train de ralentir et là où on observe encore des hausses, elles sont plus faibles que par le passé.
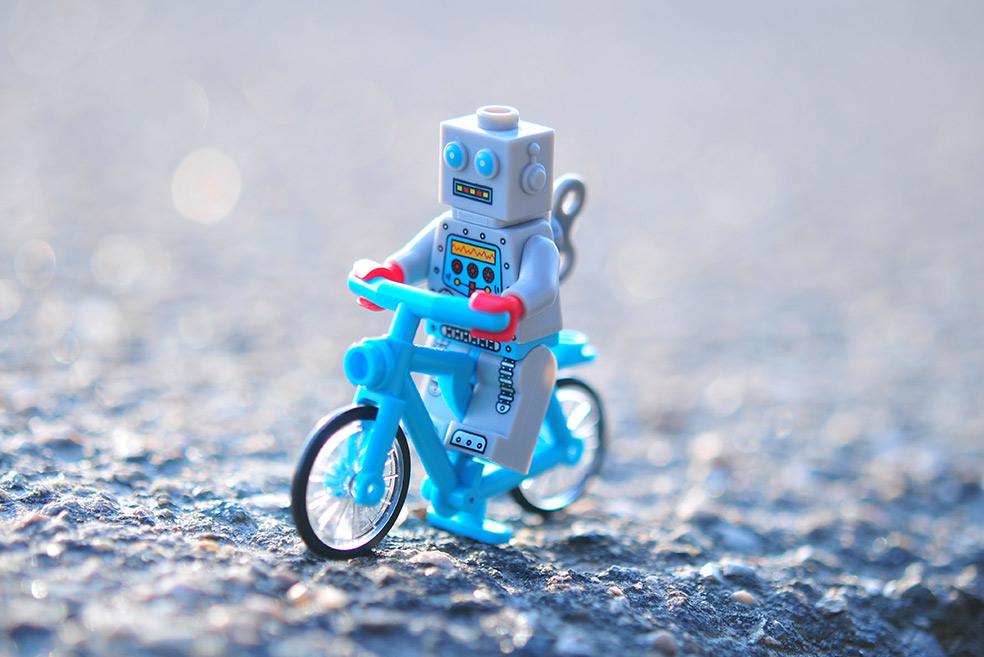
Mais alors, automatisation = chômage ?
L’économiste James Bessen de la Boston University propose l’exemple de l’industrie juridique où depuis bientôt 20 ans, des logiciels sont utilisés pour effectuer le tri de millions de documents lors de procès. Ce processus, appelé « discovery » dans la profession – représentait un coût sans précédent. Mais grâce aux méthodes électroniques, ces coûts ont pu être radicalement réduits avec des résultats bien plus précis. Etonnamment, ce processus d’automatisation n’a pas mis au chômage juristes et avocats. Bien au contraire, l’emploi des juristes et des avocats a alors augmenté de façon remarquable. Un phénomène semblable s’est produit lorsque les bancomats ont automatisé les tâches des guichets de banques et lorsque les scanners à codes barres ont automatisé le travail des caissiers. Au lieu de contribuer au chômage, le nombre de travailleurs dans ces professions a augmenté.
Alors que nous sommes persuadé que l’automatisation d’une tâche réduit l’emploi dans une profession, cette logique ne prend pas en compte certains aspects économiques fondamentaux: l’automatisation, en réduisant le coût d’un produit ou d’un service et en augmentant sa qualité, tend à attirer plus de clients. Les bancomats, en rendant moins coûteux l’exploitation de succursales, ont permis aux banques de considérablement augmenter leur nombre de branches. Les guichetiers sont ainsi devenus des spécialistes en conseil et en marketing, offrant un service plus proche de la clientèle.
Mais toute automatisation n’est pas toujours bonne pour tout le monde. Une partie de cette croissance pour certaines professions a eu lieu au détriment d’autres professions. L’arrivée des lignes téléphoniques informatisées a représenté une perte d’emplois pour les opérateurs téléphoniques, mais d’avantage d’emplois pour les réceptionnistes.
L’effet total sur le chômage dépend donc de la tendance qui sera la plus forte au sein de la société. D’où l’importance de l’innovation et de notre capacité collective d’apprentissage.
Prenez l’exemple d’un chauffeur-livreur et de son camion. Selon une vision limitée offerte par les médias (métier vs tâches), il serait remplacé par un véhicule autonome, se retrouvant ainsi au chômage. Toutefois, une simple analyse de service design nous montre qu’il lui faut encore charger et décharger les palettes de son camion et que la livraison demande toute une série d’interactions avec le client. Du moment où les chauffeurs n’ont plus à leur charge de conduire leurs véhicules, plusieurs scénarios sont envisageables. Par exemple, dans une économie de service et d’expérience, sa cabine deviendrait un bureau mobile et son travail deviendrait d’avantage focalisé sur la logistique, la vente et le conseil.

Quelles leçons en tirer ?
Le discours contemporain sur l’automatisation est complètement biaisé par des imaginaires en panne, à gauche comme à droite, encore profondément influencé par la lutte des classes et par des représentations sociales datant de la révolution industrielle qui n’ont plus de sens dans un monde globalisé et de plus en plus ouvert.
Le thème de l’automatisation est un sujet technique, économique et historique, dont le déterminisme technologique qui domine dans les médias comme dans le monde politique, nous inculque une méfiance déontologique.
La clé pour accompagner l’automatisation reste finalement notre capacité à apprendre (et aussi à désapprendre) comme à collaborer. Nous allons devoir non seulement apprendre à travailler mieux ensemble, mais également à faire évoluer nos collaborations avec les intelligences artificielles et les technologies en général. Malheureusement, on se rend vite compte que l’école a bientôt un siècle de retard, que les stratégies de transformations digitales sont souvent uniquement focalisées sur le déploiement d’outils informatiques et délaissent totalement l’humain.
Une pensée prospective, de l’innovation des business models et des services est sans doute la clé pour les entreprises qui doivent s’adapter à l’automatisation de leur secteur.
A l’heure où les intelligences artificielles sont de plus en plus performantes et siègent à des conseils d’administration, il devient urgent de repenser l’école, de repenser notre lecture critique des phénomènes socio-économiques à l’oeuvre aujourd’hui et de développer notre culture de l’innovation et de la collaboration. Pour sortir des imaginaires du 19ème siècle et créer notre futur.
Cover Photography by Robert Occhialini « Robots Are Among Us »